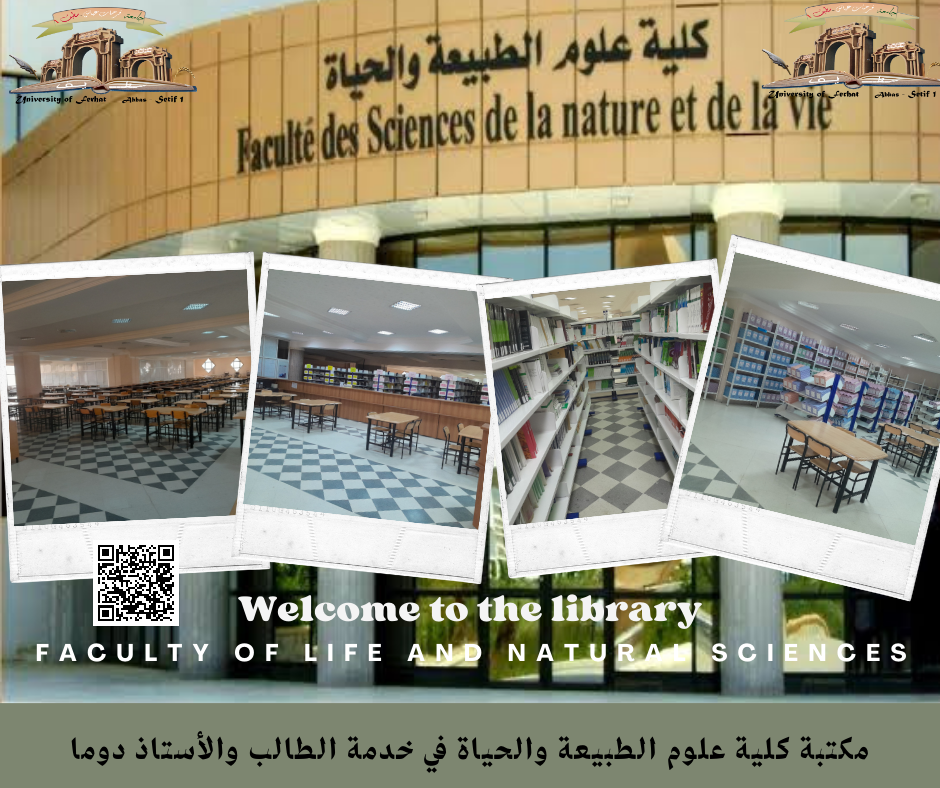|
RÃĐsumÃĐ :
|
L'AlgÃĐrie est un pays de contrastes, et l'une de ses rÃĐgions est SÃĐtif, situÃĐe au Nord-Est de l'AlgÃĐrie, se caractÃĐrise par une biodiversitÃĐ vÃĐgÃĐtale riche, favorisÃĐe par une diversitÃĐ climatique et gÃĐographique. De nombreuses plantes mÃĐdicinales y sont recensÃĐes, utilisÃĐes depuis des siÃĻcles par la population locale pour traiter divers maux. Parmi les espÃĻces les plus connues : Thymus vulgaris (thym), Rosmarinus officinalis (romarin), Artemisia herba-alba (armoise blanche), Nigella sativa (nigelle), Mentha pulegium (menthe pouliot) et autres. Les ÃĐtudes ethnobotaniques ont permis dâidentifier une centaine dâespÃĻces mÃĐdicinales, utilisÃĐes principalement pour leurs propriÃĐtÃĐs digestives, antiseptiques, antispasmodiques, et anti-inflammatoires. La transmission du savoir se fait gÃĐnÃĐralement de façon orale, souvent entre gÃĐnÃĐrations. La pharmacotoxicologie des plantes mÃĐdicinales bien que les plantes mÃĐdicinales soient souvent perçues comme naturelles et donc sans danger, certaines peuvent Être toxiques si elles sont mal utilisÃĐes (dose, mode de prÃĐparation, interactions). La pharmacotoxicologie ÃĐtudie les effets bÃĐnÃĐfiques mais aussi les risques liÃĐs à lâutilisation de ces plantes. Quelques points clÃĐs la toxicitÃĐ aiguÃŦ ou chronique de certaines espÃĻces, par exemple, Atropa belladonna ou Peganum harmala contiennent des alcaloÃŊdes puissants. Ainsi que les risques dâinteractions avec des mÃĐdicaments conventionnels. Et aussi lâimportance de la standardisation des extraits vÃĐgÃĐtaux pour garantir sÃĐcuritÃĐ et efficacitÃĐ. La nÃĐcessitÃĐ de tests pharmacologiques et toxicologiques pour confirmer les effets allÃĐguÃĐs et dÃĐtecter d'ÃĐventuels effets secondaires. Concernant lâusage traditionnel des plantes mÃĐdicinales des plantes mÃĐdicinales en AlgÃĐrie, notamment à SÃĐtif, repose sur un savoir empirique ancien, enracinÃĐ dans les pratiques culturelles et religieuses. Les plantes sont utilisÃĐes en plusieurs mÃĐthodes de prÃĐparation tels que lâinfusion, dÃĐcoction, ou cataplasme et pour des affections courantes comme les maux de tÊte, troubles digestifs, rhumes, douleurs articulaires. En conclusion, lâorganisation mondiale de la santÃĐ (OMS) reconnaÃŪt lâimportance de ce patrimoine dans le domaine de la santÃĐ primaire, tout en soulignant la nÃĐcessitÃĐ dâun encadrement scientifique pour ÃĐviter les usages abusifs ou dangereux.
|